| Collège Saint-Grégoire | Club Sportif de Jamhour | |
|
Amicale | Adhésion | Comité d'honneur | Comité directeur | Cotisations | Mutuelle | Statuts |
|
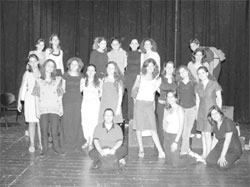 |
Joëlle Haddad (première à partir de la gauche, au premier rang) en compagnie de ses étudiantes. |
«Vous êtes dans un cocktail de mariage. Vous bavardez avec vos amis. Brusquement, l’une d’entre vous commence à se comporter d’une façon bizarre, comme si elle était possédée par un esprit. Cette attitude gagne tout le groupe et atteindra, progressivement, le paroxysme de l’excentricité. Soudain, l’une d’entre vous se calme. Vous le serez toutes, graduellement, jusqu’à ce que la fête reprenne normalement. Bon. À l’œuvre. Je vous préviens qu’il s’agit d’un exercice nécessitant une grande concentration. »
Postée derrière sa caméra, Joëlle Haddad, enseignante de théâtre et de développement personnel à l’institut de psychomotricité de l’Université Saint-Joseph, observe ses étudiantes à l’exercice. Instauré il y a deux ans dans le cadre du cursus de la troisième année de formation universitaire, cet atelier de théâtre est unique, puisque son but ultime n’est point artistique. « C’est un outil qui aide les étudiantes à développer leur aptitude à réagir dans un contexte spécifique, explique-t-elle. Elles pourront ainsi faire face à n’importe quelle situation et quel que soit le cas du patient qu’elles prennent en charge. »
« Alors, qu’avez-vous appris de cet exercice ? » demande-t-elle, en s’adressant de nouveau à ses étudiantes. « Je ne l’ai pas aimé, car il est trop violent », souligne une étudiante. « J’ai reçu un violent coup de poing », se plaint une autre. « Je n’arrivais pas à suivre le rythme des autres », remarque une troisième. Une fois que toutes les étudiantes ont exprimé leur opinion concernant l’exercice, Joëlle résume : « Le but de cet exercice est de vous apprendre à gérer vos sentiments et vos réactions ,et de vous adapter par conséquent à n’importe quelle circonstance. Cela permet de mieux se connaître et pouvoir, par la suite, mieux comprendre les autres et organiser les relations avec eux ».
D’un exercice à un autre, Joëlle Haddad montre ainsi à ses étudiantes que « la parole est secondaire », les expressions du visage pouvant refléter les sentiments des autres. Elle les pousse à réfléchir sur leur personne, sur ce qu’elles veulent, ce qu’elles aiment, à s’exprimer en public, à dépasser la timidité, à avoir confiance en soi, etc.
« J’insiste dans mon travail, notamment, sur l’imagination, constate-t-elle. Personne ne manque d’imagination. Mais en grandissant, nous refermons la porte sur cette faculté et la perdons. Mon rôle consiste donc à aider les étudiantes à rouvrir cette porte. Elles en ont besoin pour qu’elles puissent trouver des solutions aux différents problèmes qu’elles rencontreront. » Et de poursuivre : « Je travaille également sur les sentiments, qui aident à identifier les besoins. Ce cap franchi, les étudiantes pourront mieux se situer par rapport à certaines circonstances ou à certaines personnes, sans qu’elles n’émettent toutefois un jugement ou une critique. »
Séparation de rôles
« Dans le cadre de notre formation, nous devons effectuer un travail sur notre personne, souligne Sahar, étudiante en psychomotricité. L’atelier de théâtre m’a permis de le faire, comme il m’a aidé à développer mon sens de la créativité, qui est essentiel pour gérer les imprévus et reprendre une situation quelconque en main. J’ai également appris à maîtriser mon émotion. Dans le cadre de notre profession, nous traitons avec des personnes qui souffrent. Nous courons donc le risque de plonger dans leur mal et, par conséquent, dans la subjectivité. Ce cours m’a permis de prendre du recul et de développer mon sens de l’objectivité, qui est indispensable à mon travail. Mais le plus important c’est de pouvoir utiliser le théâtre comme un outil de travail, notamment avec les enfants. Cela leur permet de s’exprimer. »
Pour aider les étudiantes à mieux comprendre ce qu’elles vont apprendre sur leur propre personne, comme sur les autres, le théâtre intervient dans sa forme de « spectacle ». « Dans n’importe quelle pièce, l’acteur travaille son personnage en l’analysant, en le comprenant et en effectuant des recherches pour pouvoir le jouer, remarque Joëlle Haddad. Mais il ne fusionne pas avec son rôle. Il y a toujours une distinction entre le personnage et l’acteur. Il en est de même pour mes étudiantes. Il y a la psychomotricienne et le patient. Elle le comprend et l’aide mais ne peut, en aucun cas, prendre sa place. Elle ne peut pas devenir le patient. Cela est important, d’autant qu’elle travaille avec des schizophrènes, des enfants cancéreux, des autistes, etc. Elle doit être forte pour mieux les aider. »
La démarche suivie par Joëlle Haddad repose sur des exercices de théâtre adaptés de pièces étrangères ou de pièces créées par l’enseignante elle-même. « Depuis quelque temps, je crée les spectacles, parce que les pièces qui peuvent être adaptées à des exercices de développement personnel ne font pas légion, remarque-t-elle. Au terme de chaque exercice, nous procédons à une évaluation et à une discussion. Certains spécialistes nous reprochent de faire des thérapies de groupe. Ce n’est pas le cas. Moi j’aide les psychomotriciennes à découvrir leurs sentiments. Je ne les analyse pas. D’ailleurs, ce n’est pas à moi de le faire. »
L’atelier de théâtre est couronné, au terme de l’année universitaire, par un spectacle auquel peuvent prendre part les étudiantes des autres années également. « Je pars du principe que tout individu ne voulant pas devenir un acteur professionnel peut monter sur scène, s’il est bien suivi, souligne Joëlle Haddad. Dans cette pièce, il n’existe pas de premier rôle. Le spectacle a pour principal objectif d’aider les “actrices” à surmonter leur timidité, à faire face aux autres et à mieux s’exprimer. »
La pièce est écrite par Joëlle Haddad, qui se base, pour ce faire, sur les idées des jeunes étudiantes. « Je leur demande de m’exposer le sujet qu’elles aimeraient traiter et puis je monte le tout dans une seule pièce tout en gardant un fil conducteur », raconte-t-elle. Les universitaires ont ainsi présenté Wayna Roxane (« Où est Roxane ? ») : une pièce qui traite de la condition de la femme, de la violence, du vécu des jeunes filles en tant qu’étudiantes et de la recherche de soi.
Nada MERHI